
Codex Alimentarus, ils choisissent votre alimentation !

Bien peu de gens connaissent le Codex Alimentarius, le programme de l’ONU qui fixe en toute discrétion les normes alimentaires mondiales. Avec son nom semblant sorti d’un roman de Dan Brown, le Codex défend-il vraiment les intérêts des consommateurs… ou ceux des multinationales de l’agroalimentaire ?
Bien qu’il soit aujourd’hui rattaché à l’ONU, le Codex Alimentarius plonge ses racines dans l’empire austro-hongrois de la fin du XIVe siècle, d’où son nom latin. Le Codex Alimentarius Austriacus définissait en effet les règles d’hygiène, d’étiquetage et de commerce que devaient respecter les aliments partout sur les terres de la monarchie danubienne. Après la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe dévastée, l’accès à une nourriture abordable et respectant certains standards devient un enjeu essentiel pour la subsistance de millions de réfugiés et personnes déplacées. Cette situation de crise conduit à la création de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 1945, et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), trois ans plus tard. La première réunion conjointe des deux organisations a lieu en 1950. C’est lors de celle-ci que le politicien autrichien Hans Frenzel propose d’uniformiser les règlements alimentaires nationaux selon le modèle impérial austro-hongrois, mais à l’échelle européenne. Après des années de réunions, de comités et de propositions, la Commission du Codex Alimentarius tient sa première session formelle à Rome, en octobre 1963. Elle réunit alors 30 pays. Aujourd’hui, elle compte 189 membres : 188 pays et une organisation, l’Union européenne.
DES NORMES POUR TOUT
Le Codex n’est pas un document unique, mais un ensemble en perpétuelle expansion de normes, directives, études et autres recommandations, ayant pour objet principal la sécurité sanitaire des aliments. Le Codex établit également les standards à respecter pour l’étiquetage des aliments, leur publicité, les compléments, vitamines et minéraux, les additifs, les contaminants, produits chimiques et résidus de pesticides (notamment les limites maximales autorisées) et les aliments dérivés de la biotechnologie (OGM et aller- gènes). À l’origine, l’adoption par les États des différentes normes élaborées par le Codex était facultative, et formellement, c’est toujours le cas. Toutefois, la création le 1er janvier 1995 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a fondamentalement changé la donne, puisque l’OMC utilise le Codex comme référence pour le règlement des disputes internationales concernant les denrées et la protection des consommateurs. Les pays membres de l’OMC n’ont donc guère d’autre choix que de s’y conformer. Dans l’espace francophone, les directives du Codex sont reprises et appliquées par les organismes nationaux que sont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) en France ou l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) en Belgique. En Suisse, c’est l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui remplit ce rôle.
VERS UNE STANDARDISATION ALIMENTAIRE GLOBALE
L’OMC regroupant actuellement 164 pays, et le Codex comprenant désormais des règlements pour pratiquement tous les aliments existants, les décisions de sa Commission affectent directement la quasitotalité des habitants de la planète. Cette Commission joue aujourd’hui un rôle central dans la standardisation alimentaire globale, puisque c’est en son sein que se prennent les décisions qui régulent et contrôlent l’approvisionnement mondial, depuis les champs jusqu’à notre table. Ce ne sera une surprise pour personne : les défenseurs d’une agriculture et de systèmes écologiquement et socialement durables estiment que le Codex Alimentarius ne sert pas en réalité les intérêts des consommateurs, mais bien ceux des grandes multinationales de l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et la biotechnologique, tout en portant activement atteinte aux droits des agriculteurs et des consommateurs. Et il paraît indéniable que le Codex place souvent les intérêts économiques avant la santé humaine.
LA BATAILLE DES SUPPLÉMENTS
Un exemple parmi d’autres : depuis le début des années 1990, la Commission s’est donné pour mandat de réglementer les nutriments vendus comme suppléments, notamment les vitamines, minéraux et autres substances naturelles. L’industrie pharmaceutique, qui ne voit pas forcement d’un bon œil la popularité des remèdes naturels, tente depuis longtemps de promouvoir une législation plus stricte pour ces suppléments. La question fondamentale étant : doit-on considérer ces produits de santé comme des aliments ou comme des « remèdes » ? En 1996, la délégation allemande présente une première proposition, parrainée par trois sociétés pharmaceutiques. Radicale, celle-ci prévoit qu’aucune plante, vitamine ni aucun minéral ne puisse plus être vendu librement à des fins préventives ou thérapeutiques, et que tous les suppléments alimentaires soient reclassés en tant que médicaments. Cette proposition est acceptée par la Commission… mais ne sera jamais appliquée face à la tempête de protestations qu’elle soulève immédiatement un peu partout. En revanche, lors de la 28e session de la Commission qui s’est tenue en juillet 2005, les directives concernant les compléments en vitamines et sels minéraux ont bien été adoptées. Ces directives ne visent pas cette fois à les interdire purement et simplement, mais à imposer des règles sur l’étiquetage, la fabrication, ainsi que les dosages minimaux et maximaux autorisés. Les produits présentant une forte concentration (au-delà de l’apport journalier recommandé) et des prétentions thérapeutiques doivent être considérés comme des médicaments, et sont donc soumis à une tout autre réglementation : des normes sévères et coûteuses, qui ont pour résultat que seules les grandes compagnies pharmaceutiques sont en mesure de les fabriquer et les distribuer.
LES APPORTS JOURNALIERS RECOMMANDÉS : UN STRICT MINIMUM !
L’idée de fixer des concentrations maximales pour les suppléments est elle-même sujette à controverse. Dans l’UE, celles-ci sont limitées à trois fois l’apport journalier recommandé (AJR). Or, loin d’être une formule garantissant une bonne santé, l’AJR est simplement la dose minimale nécessaire pour prévenir les carences. Les AJR ont été élaborés pendant la Seconde Guerre mondiale, pour éviter que les soldats ne tombent malades. Aujourd’hui, la recherche sur les propriétés positives des vitamines et des minéraux se concentre sur des niveaux supérieurs sûrs, ou « apports nutritionnels optimaux suggérés » (SONA), des doses beau- coup plus importantes qui favorisent activement la santé, plutôt que de seulement prévenir la maladie. L’exemple de la vitamine C est parlant : son AJR a commencé par être fixé à 30 mg (soit l’apport minimum pour prévenir le scorbut), puis est passé à 45 mg et enfin à 60 mg, alors qu’aux États-Unis, il est de 85 mg.
PRÈS DE 300 ADDITIFS AUTORISÉS
Autre exemple : l’indice Codex répertorie actuellement un total d’environ 300 additifs – aussi bien synthétiques que naturels – autorisés aux fins suivantes : maintenir la qualité nutritionnelle, améliorer la qualité ou la stabilité de la conservation, fournir des aides essentielles à la transformation, et enfin rendre les aliments plus attrayants pour les consommateurs. À noter que le terme « attrayants » ne concerne ici que l’apparence des aliments (ou le renforcement artificiel de leur arôme) et non l’amélioration plus coûteuse et non rentable de leur substance et de leur valeur nutritive. L’effet cumulatif à long terme de la consommation de multiples additifs artificiels sur la santé des consommateurs est largement ignoré. Faut-il s’en étonner, puisque ceux-ci sont fabriqués par les mêmes sociétés pharmaceutiques et chimiques qui souhaiteraient interdire les suppléments vitaminiques et forcer les aliments génétiquement modifiés dans nos assiettes ?
Lars KOPHAL, journaliste
EN VOIR PLUS
REJOINDRE
L’ESPACE MEMBRE
POURQUOI ? Dans cet espace membre, vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, du contenu supplémentaire. Vous pouvez également bénéficier à des offres spéciales, participer à des webinaires, ateliers ou conférence.

NEWSLETTER
NE LOUPEZ PLUS UNE SEULE INFO ! INSCRIVEZ-VOUS À LA « CHOU’S LETTER » !
















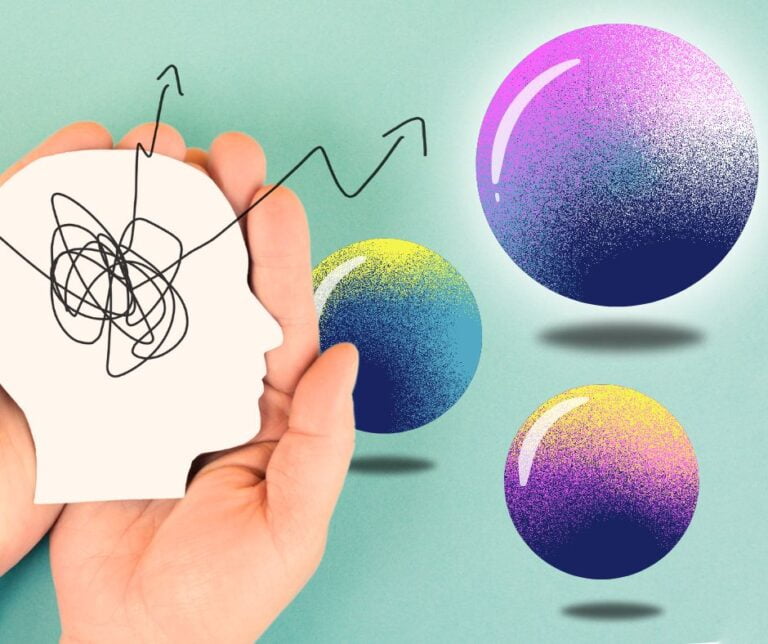





Vous devez être un membre actif pour laisser un commentaire. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.